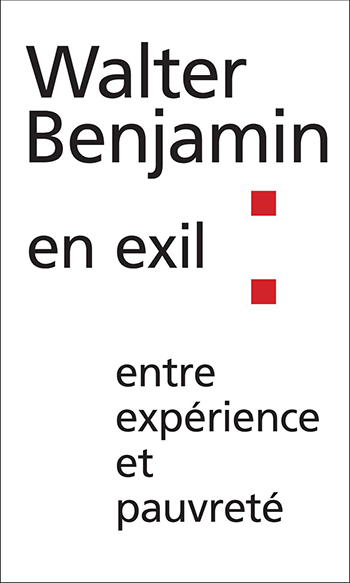|
« On pourrait inscrire l’expression française de nature morte au-dessus de la porte conduisant dans les coulisses de sa philosophie. » Th. W. Adorno, « Un portrait de Walter Benjamin », in Sur Walter Benjamin (1970) |
1) Pontcerq publiera le 17 octobre prochain un vaste ouvrage collectif intitulé Walter Benjamin en exil : entre expérience et pauvreté.
Avec des contributions de Jean-Christophe Bailly, Antonia Birnbaum, Vincent Chanson, Catherine Coquio, Alexandre Costanzo, Marianne Dautrey, Christophe David, Sonia Dayan-Herzbrun, Claudia Girola, Erik Granly Jensen, Marc Jimenez, Robert Kahn, Jean Lacoste, Esther Leslie, Henri Lonitz, Jordana Maisian, Stefano Marchesoni, Jean-Maurice Monnoyer, Nicolas Oblin, Dolf Oehler, Gaëlle Périot-Bled, Florent Perrier, Muriel Pic, Nathalie Raoux, Lionel Richard, Michèle Riot-Sarcey, Anne Roche, Marc Sagnol, Olivier Taïeb, Patrick Vassort, Bernd Witte, Erdmut Wizisla.
Suivi d’« Expérience et pauvreté » de Walter Benjamin, dans la traduction de Philippe Beck et Bernd Stiegler.
Ouvrage dirigé par Christophe David et Florent Perrier.
[ 730 pages / 15 x 25 cm / ISBN 978-2-919648-40-5 / Prix : 37,50 euros ]
2) « Il n’y a pas ici-bas d’autre force que la force, et c’est elle qui communique de la force aux sentiments, y compris la compassion. On pourrait en citer cent exemples. […] Pourquoi la nécessité des congés payés a-t-elle paru à tant de gens un axiome d’une évidence géométrique en 1936 et non en 1935 ? Pourquoi y a-t-il tellement plus de gens pour s’intéresser aux ouvriers d’usine qu’aux ouvriers agricoles ? […] De même dans l’histoire. On admire la résistance héroïque des vaincus quand la suite des temps apporte une certaine revanche ; non autrement. On n’a pas de compassion pour les choses totalement détruites. Qui en accorde à Jéricho, à Gaza, Tyr, Sidon, à Carthage, à Numance, à la Sicile grecque, au Pérou précolombien ?
Mais, objectera-t-on, comment pleurer la disparition de choses dont on ne sait pour ainsi dire rien ? On ne sait rien d’elles parce qu’elles ont disparu. Ceux qui les ont détruites n’ont pas cru devoir se faire les conservateurs de leur culture.
D’une manière générale, les erreurs les plus graves, celles qui faussent toute la pensée, qui perdent l’âme, qui la mettent hors du vrai et du bien, sont indiscernables. Car elles ont pour cause le fait que certaines choses échappent à l’attention. Si elles échappent à l’attention, comment y ferait-on attention, quelque effort que l’on fasse ? C’est pourquoi, par essence, la vérité est un bien surnaturel.
Il en est ainsi pour l’histoire. Les vaincus y échappent à l’attention. […] Les vaincus disparaissent. Ils sont néant. » (Simone Weil, L’Enracinement, 1943)
3) Le Hebel-Kolportage se poursuit anno 2025 – cette fois sous l’égide inattendue de Ludwig Wittgenstein le Viennois. Nous annonçons cette parution, accomplie par une maison amie de la maison : les éditions Pli, à Saint-Nazaire.
N. B. Pontcerq a aussi des exemplaires sous le coude si besoin : pour les Rennaises et Rennais parmi vous. Demandez.
4) On pourrait supposer que chez l’une et l’autre une telle attention ou préoccupation, ou désir, serait né en prison, de l’inactivité ; de l’ennui ; de l’impossibilité soudaine de poursuivre la lutte politique, qui avait jusque là été « toute leur vie » ; si dans le cas de Rosa Luxembourg cette attention aux animaux et fleurs qui l’entouraient n’avait de toujours existé ; si son herbier n’attestait bien avant l’enfermement à Breslau en 1917 un intérêt passionné (remontant aux années même de liberté, notamment à Berlin sur les terrains vagues et les landes de Marienfelde, en 1913 1) ; si dans le cas d’Ulrike Meinhof nous ne savions de témoignage tout aussi sûr qu’au temps du lycée déjà il lui arrivait de quitter son lit à quatre heures du matin pour aller voir et écouter les oiseaux, tels que l’aurore les offre, dans les environs d’une maison banale. (C’était à Oldenburg en 1948 ou 1949 2.) Alors les choses se renversent – et il se pourrait que le jugement le plus juste soit au contraire celui-ci : c’est la politique qui pour l’une et l’autre vint un jour par son urgence et son caractère impératif occuper le terrain, prendre la place, d’un désir (d’un souci) autrement plus profond et ancien – désir qui s’il est encore possible ensuite, écrit Rosa Luxembourg en 1918, ne l’est plus cependant qu’« en dépit de l’humanité 3 ». « Vous étiez là ! Je crois que c’est la prison tout entière qui s’en est réjouie. […] Vous viendrez me rendre à nouveau visite ? Récemment, en octobre, il y avait des cerfs-volants au-dessus de la prison, de toutes les couleurs ; ça veut dire qu’il y avait des enfants qui les faisaient ainsi monter dans les airs. […] Et ensuite les mouettes sont passées en volant – venant du Rhin. Vous connaissez les grives ? Ce sont des imitatrices. Elles sont de la famille des merles. Mais elles ne chantent pas comme les merles, pas non plus comme les rouges-queues, les pouillots, les troglodytes. Vous en avez aussi dans votre jardin ? Il y a eu un moment je voulais devenir ornithologue… Mais les ornithologues ont eux aussi un p’tit grain [Tick]. Quand même. Ils ont de bonnes oreilles. N’hésitez pas à donner des nouvelles 4. »
5) « Alors que dans le symbole, par la sublimation de la chute, le visage transfiguré de la nature se révèle fugitivement dans la lumière du salut, en revanche, dans l’allégorie, c’est la facies hippocratica de l’histoire qui s’offre au regard du spectateur comme un paysage primitif pétrifié. » (Benjamin, Origine du drame baroque allemand, p. 178) / « On pourrait dire que toute sa pensée relève de “l’histoire naturelle”. » (Adorno, Sur Walter Benjamin, p. 16) / « … alors que les relations entre les êtres vivants eux-mêmes sont tenues hors de toute temporalisation [Verzeitlichung], l’histoire naturelle se développe comme chronique [Chronik] dans laquelle chaque découverte ne peut plus être intégrée au système lui-même, mais n’est énumérée qu’à la suite, dans l’ordre de sa mise au jour… » (W. Lepenies, Das Ende der Naturgeschichte, p. 19) / « … cette transformation de l’histoire en nature sur laquelle repose l’allégorie » (Benjamin, Origine du drame baroque allemand, p. 196) / « La pensée de l’éternel retour du même serait la version “infernale” et en même temps “naturelle” – celle d’une histoire redevenant Naturgeschichte – de l’expérience de la “modernité”. » (Gérard Raulet, Le Caractère destructeur, p. 129) / « Tel est en effet un des paradoxes du Trauerspiel, que nous avons vu avec la théorie de l’histoire-nature : en présentant l’histoire comme une nature figée, il la présente comme nature des temps primitifs, comme paysage lunaire, comme préhistoire… » (Marc Sagnol, Tragique et tristesse, p. 229) / « Ainsi Babel, c’est déjà l’allégorie baroque de la “confusion inconsolable de l’ossuaire” (GS I, p. 405), celle-ci est une image dialectique de la modernité… » (Irving Wohlfarth, « Sur quelques motifs juifs chez Benjamin » [1981], p. 145) / « … ce n’est pas pour rien que son interprétation du baroque a pour concept central celui de l’ “histoire naturelle” » (Th. W. Adorno, Sur Walter Benjamin, p. 50) / « Mais en s’abîmant sans relâche dans sa méditation, [la mélancolie baroque] recueille les objets morts dans sa contemplation pour les sauver. » (Benjamin, Origine du drame baroque allemand, p. 168)
6)
 Carl Akeley, Diorama photographié / Hyènes naturalisées, 1899.
Carl Akeley, Diorama photographié / Hyènes naturalisées, 1899.
Quieta non movere !
Pontcerq,
juin 2025
1. Cf. Lettre à Luise Kautsky, 18 septembre 1915 (en prison, Berlin).
2. Cf. Jutta Ditfurth, Ulrike Meinhof, Berlin, Ullstein, 2007, p. 62.
3. « en dépit de l’humanité » est en français dans le texte de la lettre à Sophie Liebknecht, prison de Breslau, 12 mai 1918.
4. Lettre écrite à ses deux petites filles par Ulrike Meinhof au pénitencier de Cologne-Ossendorf [im « toten Trakt »] début novembre 1972 ; citée in Jutta Ditfurth, Ulrike Meinhof, op. cit., p. 362. / Ne le trouvant dans aucun dictionnaire, nous traduisons « Scherenschleifer », dialectal, par « pouillot » (les Allemands entendraient le « rémouleur » où l’on entend en français un « compteur d’écus » (zilpzalp) ?).